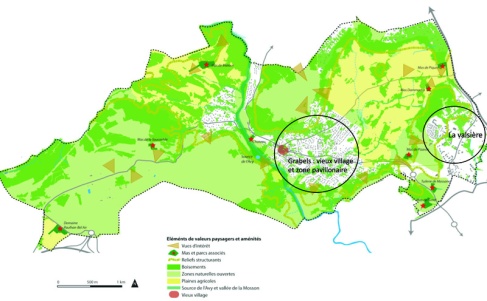Daniel Pauly est un biologiste marin français internationalement reconnu pour ses travaux sur l’impact des pêcheries sur les océans. Il est le premier à avoir cartographié et évalué les conséquences écologique, économique et sociale de la surpêche à l’échelle mondiale. Depuis 40 ans il dénonce les politiques de pêche commerciale qui vident les océans et affament les populations. Il est la preuve vivante qu’il est possible de concilier une science de très haut niveau et un engagement écologique. Rencontre au Canada où il est directeur du Fisheries Centre de Vancouver.
En 1995, dans un article du journal Le Monde, intitulé les biologistes s’inquiètent de l’abus de la pêche industrielle, vous parliez déjà d’un « pillage écologique des mers ». Il y a combien de temps que vous étudiez les ravages de la surpêche dans le monde ?
Il y a 40 ans que je travaille sur cette question. Dès le début de ma vie professionnelle, en Indonésie, j’ai été alerté par le déséquilibre entre le nombre de pêcheurs et les ressources de la mer. Le long de la côte de Java, j’avais observé des pêcheurs qui partaient en mer à 5 ou 6 sur une barque et qui revenaient le soir avec 1 ou 2 kilos de poissons. C’était une surpêche côtière, les poissons au large n’étaient pas exploités parce qu’il n’y avait pas encore de chalutier, mais c’était déjà une indication du problème. Je me rendais compte qu’il avait une centaine de millier de pêcheurs le long de la côte qui n’attrapaient rien. Il y avait déjà une surpêche énorme en 1975
A cette époque, on était en train de développer les pêcheries. J’ai participé en 1975-1976 à l’introduction du chalutage en Indonésie en faisant des campagnes de chalutage pour évaluer la taille des stocks des poissons. J’ai compris beaucoup plus tard que ces études permettaient au gouvernement d’obtenir des crédits des banques de développement pour acheter des bateaux de pêche. Sur une période de 3/4 ans, des gens faisaient fortune surtout grâce à l’achat de bateaux subventionnés par ces banques. Résultat, quelques années plus tard, il y a eu une situation de surpêche dans la zone avec une surcapacité de bateaux. Les propriétaires des chalutiers gagnaient de l’argent alors que leurs équipages pratiquement rien. En plus, la misère des pêcheurs artisanaux avait augmenté.
En 1979, quand j’ai commencé à travailler après avoir obtenu mon doctorat, les Philippines étaient déjà dans une situation de surpêche. La pêche s’était développée beaucoup plus vite dans ce pays à cause des américains qui avaient laissé une quantité d’équipement à la fin de la deuxième guerre mondiale. Ils ont mis des moteurs de jeeps sur des bateaux et le chalutage a commencé. Il s’est répandu ensuite dans le reste du monde.
De quelle année date votre premier article alertant des dangers de la surpêche ?
En 1979 ; Il s’intitule «Theory of managment of tropical fisheries ». C’est un papier que j’ai écrit en 1978, quand j’étais jeune consultant pour l’ICLARM, un centre de recherche sur les pêcheries qui venait d’être créé aux Philippines. A cette époque, les gens n’avaient pas du tout réfléchi au problème de la surpêche dans les pays tropicaux ; il a donc été un des premiers articles sur le sujet.
Comment a été accueilli ce papier dans le milieu scientifique ?
Il a été très bien accepté, bien cité et il l’est encore. C’est lui qui m’a lancé en quelque sorte et ça m’a aussi créé un emploi parce que c’est sur la base de ce papier que le directeur de l’ICLAM m’a engagé à la fin de ma thèse, en 1979. J’ai travaillé aux Philippines pendant 20 ans et j’ai fini directeur de l’un de ses 4 programmes de recherche.
Vous qui avez une connaissance précise de la dégradation des océans, quand vous voyez la situation empirer, est-ce que ce n’est pas déprimant ?
Les scientifiques ont une façon de travailler qui leurs permettent de vivre ça : la compartimentation. En fait il y a un côté tout à fait décourageant : le fait de savoir qu’on détruit des ressources qui pourraient très bien subvenir à nos besoins, mais de l’autre côté, c’est un défi scientifique : on se demande comment on peut démontrer qu’il y a une surpêche. Si demain on annonçait la fin du monde du au volcanisme, les volcanologues, ça les intéresseraient …
Est-ce que ce n’est pas aussi un défi politique ?
Oui, c’est aussi un défi politique mais pour les scientifiques c’est toujours une danse, une chorégraphie. Il faut à la fois rester dans la science mais aussi se pencher vers les politiques pour leur expliquer ce qui se passe.
Avez-vous été approché par l’Union Européenne comme expert sur les questions de la pêche ?
Oui, l’Union européenne m’a demandé de faire une étude sur les pêcheries de la Chine dans le monde.
Et aussi par rapport à leur politique de la pêche ?
Non, parce que moi je n’ai pas développé d’expertise dans les zones européennes, mon expertise c’était surtout les zones tropicales. Donc on m’a consulté surtout autour des problèmes de surpêche dans les zones tropicales.
Pourtant dans vos articles vous dites que les bateaux européens vont pêcher au large de l’Afrique …
Ah oui ça c’est vrai ! D’ailleurs on voit bien leurs bateaux! Mais ça ce n’est pas la politique européenne, c’est la politique « extérieure » européenne. J’ai travaillé sur cette dernière superficiellement, je m’intéresse à toutes les pêcheries du monde. Par contre les pêcheries tropicales, je les connais plutôt bien.
Selon vous, pourquoi l’Union Européenne persiste-t-elle à pêcher au large de l’Afrique ?
Parce que dans notre économie, ceux qui nous gouvernent donnent une énorme autonomie aux entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils font ce qu’ils veulent et n’ont pas beaucoup de freins à leurs activités. En fait c’est souvent l’économie qui pousse la politique plutôt que le contraire. C’est parce qu’il y a de l’argent à gagner en Afrique que l’on surexploite ses ressources et que l’on envoie des bateaux. Il y a des subventions pour ça. Il y a toute une activité européenne en Afrique qui n’est pas à l’avantage de l’Afrique, mais qui profite aux armateurs européens. J’ai dénoncé ça dans mes articles scientifiques , dans des campagnes d’informations et des conférences à Dakar par exemple.
Est-ce que cela a amélioré la situation au Sénégal ?
Oui cela a eu un impact parce que finalement les accords de pêche qui permettent aux européens de pêcher en Afrique sont devenus plus transparents. Ils ont des termes moins défavorables qu’avant. Les choses vont mieux du côté politique, par contre les européens sont remplacées graduellement par les chinois et ça ce n’est pas sans problèmes parce que là il y a tout à faire en ce qui concerne la transparence et le respect dans leurs pratiques.
Mais ce qu’il est important de savoir, c’est que la durabilité des stocks de poisson est mise en cause autant par les Européens que par les chinois, il n’y a pas une grande différence. D’ailleurs les gens du Parlement Européen ce sont vexés quand j’ai présenté mon étude en leur disant que la Chine n’agissait pas vraiment différemment des européens.
Vous faites souvent référence au travail des associations non-gouvernementales. Ont-elles plus de pouvoir pour faire changer les politiques environnementales ?
Oui parce que quand on étudie comme moi la pêche, on remarque que les scientifiques, même s’ils travaillent pour le gouvernement, ne sont pas souvent écoutés. Les gouvernements prennent des décisions raisonnables quand ils sont forcés de le faire. Il n’y a que les associations écologiques qui soient capables de reprendre le discours des scientifiques, de l’expliquer et de forcer les politiques à en tenir compte.
Vous devez être souvent sollicité par des associations de protection des océans?
En fait, an début, c’est moi qui les ai sollicités. Quand je suis arrivé ici, au Canada il y a 20 ans, j’ai décidé de m’allier à des associations écologistes. Je voulais faire passer l’idée qu’il faut absolument que les stocks de poissons soient gérés d’une façon durable.
Le Canada malgré toute la science qu’il a accumulé, a ruiné son stock de morues parce que la pêche à outrance était entérinée par les politiques, l’industrie et les armateurs. Et les scientifiques qui disaient « ce n’est pas ça qu’il faut faire » n’étaient pas écoutés, comme dans les pays du tiers-monde.
Devant ce constat, je me suis demandé quelle force sociale pourrait bloquer ce processus destructeur et je me suis allié à ces associations écologistes . Avec eux, c’est une autre danse parce qu’elles s’attendent à ce qu’on devienne des avocats et ça je ne peux pas le faire puisque je suis scientifique. Donc je continue à publier, mais j’essaie de faire des choses qu’ils peuvent utiliser et je crois y être parvenu parce qu’ils citent mes travaux énormément. C’est une « liaison dangereuse », mais qui fonctionne. Par contre, il y a très peu de scientifiques qui le font explicitement. La plupart d’entre eux ont peur des associations. Moi je n’ai pas peur ; je sais comment travailler avec elles.
Est-ce que vous suivez ce qui se passe en France au niveau de l’écologie ?
DP Oui, mais les mouvements écologistes en France sont très différents des mouvements écologistes en Amérique du nord. Ici ces groupes ne s’occupent que de l’écologie. En France c’est un mouvement politique de gauche, on les retrouve partout où il y a la gauche : Aux États-Unis, les écologistes et les associations écologistes ne s’intéressent qu’aux problèmes de l’écologie et c’est pour ça qu’elles peuvent s’allier au partis de droite au besoin. Maintenant ça devient de plus en plus difficile parce que la droite, aux Etats Unis, est devenue complètement cinglée , mais il a été possible jusqu’à présent de ne pas prendre parti, alors qu’en France c’est toujours un parti de gauche. C’est restrictif.
Moi je suis une personne de gauche et le problème ce n’est pas le fait que ils soient à gauche, c’est qu’ils impliquent l’écologie dans un contexte uniquement politique alors qu’elle doit être vue dans un contexte scientifique. C’est pour ça que les Verts en France n’arrivent pas à percer et ne deviennent pas des groupes puissants comme en Allemagne ou aux États-Unis. Ces ONG écologistes participent à toutes les grandes décisions et ont beaucoup de pouvoir. Malheureusement, ce n’est pas le cas au Canada, où les associations écologistes n’ont aucune influence.
Pourquoi ?
DP Parce que le gouvernement fédéral, de droite, veut tout contrôler pour faire passer sa politique en faveur du pétrole extrait de schiste bitumeux. Les canadiens, malgré l’impression qu’on a en Europe, ne s’intéressent pas à l’écologie. Le fait que les canadiens sont perçus comme « verts » est dû au fait que le pays n’est pas très peuplé et qu’il y a encore beaucoup de nature autour de nous. Mais le Canada est un pays très pollueur.
Dans votre TED Talk de 2012, vous expliquez le syndrome de la référence glissante « shifting baseline syndrome »: une sorte de mémoire à court terme de la plupart des gens, dont les scientifiques, qui partent toujours de l’état le plus récent de la planète en oubliant ce qu’elle était dans le passé.
Exactement
Cela expliquerait pourquoi les gens sont inactifs et semblent à avoir du mal à réaliser l’ampleur des dégâts dans la crise environnementale actuelle?
Oui, ils ne comprennent pas la gravité de la situation, ils ne savent pas qu’ils ont perdu une autre partie de ce qu’ils essaient de protéger.
Est-ce que ça ne serait pas un genre de « kit de survie » que les humains utilisent pour aller de l’avant parce que sinon ils seraient complètement déprimés ?
Tout à fait. Au niveau de l’évolution, on n’a pas besoin de mémoire : A quoi ça servirait de se souvenir intensément de choses qui ont affecté nos grands parents ?
Des personnalités comme Rachel Carson, ou Théodore Monod, qui ont défendus la nature toute leur vie, ne sont-ils pas justement ceux qui regardent la terre telle qu’elle était dans le passé ?
On peut le faire maintenant parce que l’on vit dans une société où l’écrit est important. C’est lui qui nous permet de retourner en arrière, grâce à la documentation sur les situations antérieures. C’est un élément nouveau, qui existe depuis 6000 ans. L’’homme existe depuis 200,000 ans. Au début, pour l’être humain il n’y avait aucun avantage à faire passer des souvenirs d’une génération à une autre. Il y a quelques expérience qui sont nécessaires mais que si elles sont renforcées. Par exemple si on trouve certains champignons vénéneux, c’est important de mentionner ça à vos enfants parce qu’autrement ils vont les manger ; mais si vous changez de paysage et que vous allez dans un coin où ces champignons ne poussent pas, ce n’est plus nécessaire de garder ce savoir : Alors il disparaît. Le savoir disparaît lorsqu’il n’est plus dans les têtes des gens, mais maintenant c’est différent parce qu’il existe dans les musées, les bibliothèques.
(Vancouver juin 2015)
Pour en savoir plus :
- Daniel Pauly a mis en place Fishbase , une base de données mondiale sur la biologie et l’écologie des poissons, qui est aujourd’hui utilisé par de très nombreux chercheurs, gestionnaires de pêches, et acteurs de la conservation.
- Son projet Sea Around Us qui effectue la synthèse des prises de pêche sur tous les océans permet de comprendre l’impact de la pêche sur écosystèmes marins mondiaux
- Dossier Greenpeace sur la suprêche en Afrique de l’OUEST